« notre plage nocturne »
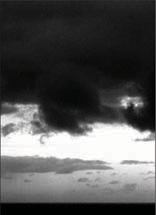
{ Sur Défiguration & L’Éternel retour de Michel Surya}
La parole devrait pouvoir se suspendre là où la littérature porte elle-même sa pensée. La parole sur la littérature – article, note, présentation, critique – faisant un pas de côté, par rapport à elle. Abolie par un processus radieux, euphorique, redonnant sens à la création d’un univers de mots et donc, d’un monde, un espace fou et souverain.
Il n’y aurait de commentaires que comme les décorations d’une fête oubliée, ou comme des papiers accrochés aux arbres par le vent, flottants, fragiles, à la merci de la moindre bourrasque les débarrassant, en entraînant d’autres aux rets des mêmes branches, sans fin.
L’on imaginerait alors vraiment à quel point l’écriture peut être un rapport intime, non pas simplement d’intellect à intellect ou de références à références, de mémoire à mémoire, mais de sensibilité à sensibilité, au sein même de la création d’une langue proclamant que tout est possible, malgré tout.
« Une épouvante de chien sous l’orage »
Défiguration déroule un univers monochrome – un blanc de neige étouffant toute possibilité de fuite de ce monde clos – d’angoisse et de mort. Celle de l’écrivain Édouard Adler. Sa cécité le plonge dans une obscurité lui permettant une distance suffisante avec son œuvre passée, avec le monde pour qu’ils ne l’anéantissent pas complètement, ainsi qu’il aurait été logique qu’ils le fassent, de façon fulgurante, depuis longtemps. Dans un processus exemplaire et attendu. La mort de celui qui a vu, pensé, aimé, écrit. Mais Édouard Adler est vivant, malgré tout. Dans cette outre-vie paradoxale. À-pic de douleur et de détachement. Rescapé des camps, survivant à la femme aimée, survivant à la torture de la vie après ces morts-là. Une vie d’ombre en attente, non pas de « retrouvailles » ou de « rachat » – tel n’est pas l’univers développé – mais d’un épilogue.
[lire la suite]
Défiguration commence après la mort d’Édouard Adler, annoncée de façon liminaire, et lui redonne donc vie, après sa mort. Plus exactement, le roman s’ouvre sur l’intrication de l’amour et de la mort, sur le sentiment que la mort puisse être aimée, désirée, enviée, offrir un visage de sérénité ainsi que la possibilité d’aimer le défunt, pour ses derniers instants même. « J’aime la mort que s’est donnée Édouard Adler. C’est même à l’amour que j’ai de cette mort que je dois de savoir combien j’aimerai ce mort, désormais. D’un amour qui ne l’en sépare pas. » Comme une mise en abyme du roman même, l’histoire tourne en rond avec pour entrée et issue, la mort. Elle seule reflétée dans ce jeu de miroir formel qui loin de chercher à perdre le lecteur le concentre sur la voix qui va s’élever pour raconter les derniers jours d’Édouard Adler et tenter d’en éclairer le sens, des yeux d’un observateur-narrateur venu travailler auprès de l’écrivain, bravant l’atmosphère lourde et pesante d’une campagne enneigée comme une conscience trop lourde.
Le narrateur se substitue aux yeux d’Édouard Adler qui, quant à lui, ne s’attache qu’à s’ensevelir sciemment, construisant sa mort « comme (...) s’il n’y eût plus rien à voir. » Pris d’une sorte de frénésie, l’écrivain lui demande peu à peu de tout détruire, pour que rien ne subsiste. Le narrateur est obsédé, possédé par son travail d’effacement. Par le magnétisme d’une œuvre en cours de destruction, une œuvre dont l’auteur ne souhaite que la destruction. L’œuvre semble se venger sur celui qui, physiquement, la laisse filer entre ses doigts pour la détruire : « elles (les phrases) semblaient de force à réduire à rien tout ce qu’avait, patiemment, avec obstination, tenté de penser celui qui devait les réduire à rien. Vouées à n’avoir bientôt pas plus de réalité qui si elles n’avaient jamais été écrites, elles distillaient, avant de disparaître, assez d’atroces insinuations pour que ce fût celui qui les lisait qui fût comme s’il n’avait jamais lu qu’elles. Pour que ce fût celui qui avait à les détruire qui se sentît menacé de disparaître. »
Car Édouard Adler a écrit après les camps, après l’extermination. C’est cela qui crée l’irréductibilité de sa démarche, la nécessité de son destin.
« “N’être pas mort avec ceux qui sont morts me fait être le même que ceux qui les ont tués.” »
Michel Surya écrit Édouard Adler qui écrit après les camps. C’est en cela qu’il développe l’une des rares œuvres parvenant à penser cette rupture totale de l’histoire et de la pensée en l’inscrivant dans l’art, dans la pensée. Michel Surya cerne ce point de non-retour dans le roman même, d’un geste fou, un geste de respect et d’amour. Un geste qui révèle à quel point l’on ne peut qu’écrire après, après tout, même si c’est dans un désespoir inévitable, dans une certaine opacité formelle : « “Ce qui devait être écrit ne l’a pas été. Ce qui l’est ne l’aurait pas dû. (...) On ne répare pas l’horreur d’avoir survécu par celle de dire comment. Il n’y a plus pour moi, depuis, de livres qui ne trichent.“ »
On imagine à quel point, dans une spécularité vertigineuse, le commentaire de cette écriture de l’après ne peut, a fortiori, qu’en fausser les enjeux et la portée. On ne peut dérouler l’écheveau de cette littérature qui pense ou de cette pensée qui s’écrit sans en sabrer l’effet, et la portée. Outre l’événement de la langue en elle-même, l’écart entre le subjectif et le collectif empêche que l’on puisse espérer éclairer quelque chose de ce qui ne cherche pas à être éclairé mais à s’imposer comme un monument d’obscurité, une butée de l’émotion et de l’esprit sur un point aveugle de l’imagination.
« “Nos vies, si désespérées parfois soient-elles, n’atteignent qu’au malheur. Il n’y a de tragédies que collectives. Qu’anonymes et collectives.“»
C’est pourquoi, tout comme le narrateur ne fait que rapporter les propos d’Édouard Adler et la progression de ses activités de secrétaire-destructeur d’une œuvre ne souhaitant que sa destruction – se mettant pour ainsi dire en retrait de l’action –, nous ne pouvons qu’agencer les éléments créés par la langue de Michel Surya pour en faire surgir les enjeux, sans vraiment de supplément théorique.
« Le plus compréhensible : il porte cent corps dans son corps, et morts. Il est le même que ce que sont ces corps portés morts par lui. Ce qu’il dit – j’imagine – ne s’adresse à rien ni personne qui ne compte parmi ces corps qu’il lui faut porter depuis que ceux-ci l’ont réduit à leur anonymat.
L’imaginable : cette nuit, dehors, de vent bas, de neige et de boue, dedans le feu mal pris (aussitôt éteint), ce n’était pas sur lui mais sur tout ceux qui disparaîtraient avec lui, une seconde fois, sur tous ceux dont il s’imaginait qu’ils n’avaient plus que lui pour n’être pas abandonné à l’oubli, qu’il pleurait. »
Michel Surya parvient à créer une œuvre close, une machine solitaire, un fort langagier dissuadant tout commentaire. Car il est forclos dans la création même et nécessite l’expérience directe du lecteur. C’est une œuvre qui rebute l’analyse car elle porte en elle tous les éléments de sa pensée. Une œuvre qui proclame la souveraineté de l’œuvre elle-même.
« Il faut que la littérature sauve tout et tous, c’est-à-dire, il faut qu’elle relève. »
Là où Défiguration était neige, angoisse et mort, L’Éternel retour se tourne vers la possibilité d’un horizon lumineux, développé par la pensée et par l’amour. À la narration limpide du premier roman, habité d’une langue haletante, succède l’invention d’une forme intriquant roman et pensée, que Michel Surya appelle un « roman de pensée ». Une forme complexe déjouant toute tentative de simplification théorique tout en s’affirmant par la simplicité de son alternance dialoguée – au sens de la limpidité d’un dialogue socratique. Pas à proprement parler un « roman philosophique » – il n’en a pas le dogmatisme ni le style démonstratif – mais une narration qui intégrerait en elle-même des éléments philosophiques, comme des éléments d’actions ou les caractères de personnages décisifs. En outre, formellement, des parenthèses permettent d’accéder au monologue intérieur du narrateur.
D’ailleurs, outre le souvenir d’Édouard Adler présent à l’esprit du narrateur – qui est bien le secrétaire de Défiguration, plus âgé – y apparaît un nouveau personnage, Dagerman, qui semble représenter l’une des figures possibles de l’auteur de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier tout en affirmant ici son statut de personnage. Il ne s’agit pas d’une transposition directe d’un personnage historique, mais d’une inspiration. Si le Dagerman de L’Éternel retour semble bien un philosophe et un écrivain reconnu, le titre de l’œuvre maîtresse qu’on lui suppose, Le Décept n’est pas de Stig Dagerman. (Le « décept » - et ce n’est pas un hasard dans ce roman où la photographie a presque le rôle d’un personnage – est notamment un concept esthétique se rapportant aux techniques de reproductions artistiques démultipliant l’œuvre. Et la mélancolie qui s’y attache.) En même temps, la biographie de Stig Dagerman, proche, ne cesse de hanter la figure de Dagerman et on ne peut que garder à l’esprit la mort tragique du philosophe. Si le dialogue s’inscrit au vif, dans la mesure où il est au passé, l’on ne cesse de se demander si le personnage connaîtra la même fin ou si ce dialogue s’inscrit déjà, sans qu’on le sache, après la mort de celui-ci, tout comme c’était le cas dans Défiguration, le roman commençant alors qu’on apprend de la voix du narrateur la mort d’Édouard Adler.
La même structure se répète donc sans se répéter exactement de Défiguration à L’Éternel retour, puisqu’à une mort romanesque, posée en principe, succède une mort supposée, mythique, comme une menace sous-jacente pouvant infléchir ce que l’on va lire, du sceau de l’irrémédiable.
En outre, l’effet de réel induit par ce nom, Dagerman, fait qu’on ne peut s’empêcher de se demander si les philosophes qui sont écrits dans ce roman (Nietzsche, Hegel, Deleuze, Bataille...) ne sont pas eux aussi, pour une part, réinventés, recrées par l’écriture, leurs concepts investis, infléchis par les personnalités contrastées du narrateur et de Dagerman.
Ainsi les théories développées le sont-elles dans une constante reformulation des deux personnages affrontant tour à tour leurs points de vue contradictoires principalement concernant les notions de « consolation », de « déception », et de « répétition », la figure de Nietzsche incarnant leur désaccord, « prestidigitateur » réinjectant de la croyance et de la magie dans le monde pour Dagerman, philosophe-artiste servi par les conséquences involontaires mêmes de sa pensée pour le narrateur : « Ce n’est pas bien parler d’une pensée (...) que de ne pas tenir pour une très grande chance aussi, c’est-à-dire pour une chance dont il faut savoir gré à toute pensée, même les conséquences involontaires de celle-ci. »
De ce conflit d’idée naît la progression du roman, un nouveau jeu de miroir où chaque certitude théorique est contredite par l’affirmation suivante, comme pour mieux incarner l’instabilité inhérente au travail même de la pensée.
Cette progression complexe n’en est pas moins à la recherche d’un horizon, une finalité possible. Détail thématique qui a, à ce propos, son importance, le roman s’ouvre et se termine sur un horizon de points de suspension, l’invention d’un horizon suspendu : celui d’une parole tranchée dans le vif, d’une séquence de pensée s’inscrivant dans l’univers plus vaste de la réalité du lecteur. L’Éternel retour s’inscrit comme une pause. Un point d’orgue entre deux séquences historiques données, pour chaque conscience lectrice. Car les questions que se posent le roman sont celles d’une possibilité de consolation par la littérature ou par l’amour, et de la mort.
La figure de l’amour y apparaît ainsi sous les traits d’un personnage féminin : Nina, la femme aimée par Dagerman et qui l’aime – ce qui contraste fortement avec les figures féminines de Défiguration, disparues ou effacées. Ici l’amour est une chance pour la vie tout comme la pensée. Une chance ambiguë et aléatoire.
Un double paradoxe s’installe en effet durablement, centré sur ces deux possibilités : l’amour et/ou la littérature. C’est ce battement qui va informer le rythme du texte et son évolution.
Si l’amour est la condition sine qua non d’une possibilité de bonheur, c’est une issue fragile, inconstante, unique. « L’amour n’est pas fait pour consoler, sans doute – il est fait pour sauver. Mais, on le sait bien, on n’est jamais sauvé qu’une fois. Et on ne l’est qu’aussi longtemps que cette fois dure. Il faut le mesurer alors : c’est un minuscule miracle. » Dagerman contredit ainsi la possibilité d’un quelconque « retour » de l’amour. L’amour est une suspension dans le temps dont l’issue ne peut être que fatale : « il y a des bonheurs trop grands. Trop grands, c’est-à-dire dont il faudrait que nous précipitions la fin, de peur que leur fin ne précipite la nôtre. » L’amour rend donc vulnérable, plus que tout au monde et particulièrement les êtres que l’on croirait épargnés, métamorphosés par la rencontre de l’être aimé comme par une « révélation » : « Qu’est-ce qui valait le mieux ? (...) l’indifférence ou j’étais ? ou l’angoisse ou je suis ? »
De même, le roman est-il brandi par le narrateur comme ce qui pourrait constituer une consolation possible, la seule consolation possible, et répondre ainsi à l’échec désespéré d’Édouard Adler : « {écrire des romans } Pour créer des personnages. Pour ne plus jamais cesser de créer des personnages. Pour ne plus jamais cesser de le pouvoir. Et la raison en était évidente, bien que je ne l’aie pas vue vite : pour pouvoir créer tout un peuple après qu’on eut tenté d’en détruire un tout entier. Pour pouvoir recréer tout le peuple qu’Édouard Adler avait vu détruire. Pour pouvoir recréer tous les peuples détruits. En réalité, pour pouvoir recréer tout ce qui est détruit.» Mais à cet emportement succède un constat : « ... c’est la tâche de la littérature que tout existe et existe assez pour que nul n’en ignore l’existence ni ne l’abandonne dès lors. En même temps, c’est une tâche impossible. »
Amour, roman, double aporie, pour chacun des personnages. Impasse pour le lecteur en même temps que structures de labyrinthes dévoilées sous ses yeux dans un mélange d’euphorie et d’angoisse. Polyphonie bruissante détaillant les issues sans les montrer du doigt. Au sein de cette conversation d’une tension dramatique, le lecteur ne peut que se tenir dans cet entre-deux, balançant au gré des voix dominant la scène... Il ne s’agit pas de choisir son camp ou de trouver le meurtrier et l’arme du crime. L’Éternel retour, à travers le roman, parvient à la fois à créer un univers de pensée foisonnant, généreux, tout en donnant vie à des personnages incarnés dans l’épaisseur d’une existence cherchant sa finalité et son issue. « L’amour aurait suffi à Nietzsche, n’est-ce pas, demanda Dagerman.» À chacun de discerner son geste de surcroît.
Défiguration, Éditions Léo Scheer, janvier 2006.
L’Éternel retour, Éditions Lignes / Léo Scheer, janvier 2006.
Photo : Catherine Hélie.Note publiée, avec davantage de développements, dans La Revue Littéraire du mois de janvier 2006.




2 commentaires:
"commentaire comme les décorations d’une fête oubliée" ou d'une fête imaginée pour n'avoir tenu ces livres entre les mains. Ne trouvez-vous pas que le commentaire du personnage Dargerman « L’amour aurait suffi à Nietzsche » contredit le sens que lui donne l'auteur Dagerman? Dans le deuxième versant de "Notre besoin de consolation..." l'amour (et l'amitié) apparaissent et amènent le promeneur un peu plus loin sans nullement le rassasier (j'essayerai de retrouver le livre et la phrase).
... ainsi que je l'ai écrit, en effet :
"personnage Dagerman" n'égale pas "auteur Dagerman", vous le rappelez vous-même.
Quant à "l'auteur Dagerman", on peut effectivement toujours lire ou relire Notre besoin de consolation..., ici par exemple : http://perso.wanadoo.fr/chabrieres/texts/consolation.html
Quant au reste, la fête ne fait que commencer dans toutes les bonnes librairies...
Enregistrer un commentaire