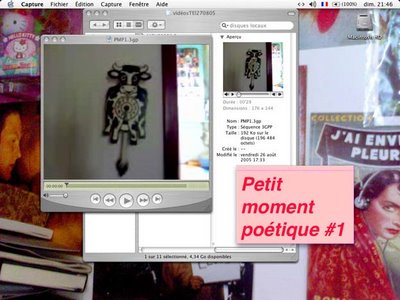Trouver la bonne coupe
{lectures texturisantes}
« _ La divergence des significations que peuvent prendre les coiffures oblige à bien réfléchir avant de se mettre à natter. À cause de ma texture et de ma forme de cheveux, j’ai déjà pour ma part rencontré ce problème de contresens dans l’interprétation de mes nattes. Colonne constat : “Cuir souple et mobile, racine bien irriguée, cheveu dense en bonne santé.” Justement, j’ai beau les faire tenir avec de vrais animaux en peluche achetés dans la vraie solderie, ces nattes réalisées à partir de cheveux trop abondants et implantés trop bas n’obtiennent pas la légèreté voulue. Colonne alerte : “Risque de confusion de ces nattes dans l’esprit d’Aragon avec les nattes autoritaires des Mexicaines dans les fractions matriarcales de la société, qui se portent debout devant un empilement de parpaings, une bière à la main.”
(...)
Un jour, j’ai attendu un très long moment dans un fauteuil de salon de coiffure avant que la coiffeuse puisse s’occuper de moi. (...) Comme je n’étais là que pour une simple coupe, je ne nécessitais pas de longue discussion. Tout le débat technique se concentrait au bac de teinture où une cliente faisait l’inventaire des couleurs du nuancier. Avec la complexité des tableaux peints, le nombre d’heures passées en discussions techniques s’est multiplié dans les salons de coiffure, la mention coloriste se rapproche du métier des imprimeurs ou de la peinture classique : dégradés, glacis, transparences, invention colométrique. Au bac de teinture, plusieurs coiffeuses faisaient lentement tourner le nuancier autour de la tête de la cliente : peu de mouvements, beaucoup de réflexions. Hors du débat, dans mon fauteuil contemplatif, j’assistais à une sitcom très lente proche du butô, une sitcom à très haut niveau technique. » *
« ... Je suis passé plusieurs fois devant la vitrine pour y jeter un regard inspectif sans donner aux deux blondinettes l’occasion de préparer par avance le petit discours réconfortant que tout coiffeur vaguement charitable sert à la, certes antithétique, catégorie chauve de sa clientèle. (...) la coiffeuse qui s’approche de moi et que je vois dans mon dos nous considérant tous deux comme dans le cadre d’une scène de genre, maintenant relevé frais frictionné du bassin de shampooing et assis droit face à la grande glace, doit certainement penser je vois que vous vous livrez à une étroite observation scientifique, vous avez délimité sur votre tête la plage bien nette d’une conscience réfléchie, mais n’en dit rien.
Elle me demande seulement à quelle hauteur régler la lame de son rasoir, de toute façon pour ce qui reste, dis-je avec l’espoir d’attirer une consolation inédite, et la blondasse de murmurer sur un ton de déploration, tout en réglant la coupe sur 2 cm, oui en effet. Puis elle ne prononce plus un mot et s’exécute méthodiquement. Je lui adresse quelques sourires lorsque sa concentration marque un temps et que nos regards se rencontrent, mais sans doute veut-elle juste évaluer l’effet du rasage en fronçant les yeux, tentant d’imbriquer l’ovale visage dans la caisse crâne, mon sourire signifie ça n’a pas d’importance n’est-ce pas l’ampleur obscène de ma peau nue sur ma tête, car j’ai la capacité de me tenir tout entier dans ma bouche. » **
-----
*Emmanuelle Pireyre, Comment faire disparaître la terre ? (Le Seuil, Fiction & cie.)
** Éric Meunié, Auto Mobile Fiction, (P.O.L.)